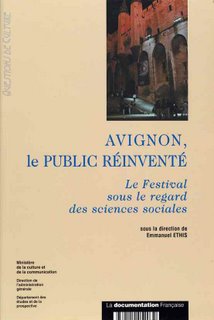Présentation du numéro
Par Emmanuel Ethis et Jean-Louis Fabiani
« Il y avait en elle une sorte de vulgarité élégante. Je pense que c’était très important… L’impact charnel… Je ne suis jamais allé dans sa loge pendant qu’on la maquillait. Il y avait un rapport amoureux entre la caméra et elle. On ne voyait qu’elle à l’écran. Elle le savait. Il y avait une autre fille dans l’orchestre qui avait les cheveux blonds. Et Marilyn m’a dit : « Pas d’autre blonde. Je suis la seule blonde ».
Billy Wilder
La question du traitement du corps est centrale dans l’histoire du cinéma. Les formes primitives de ce medium ont simultanément exploité les manières habituelles de montrer les corps dans les arts forains dont il est le prolongement indirect, et inventé de nouvelles possibilités de les mettre en scène, de les représenter ou les faire disparaître et réapparaître à volonté. Pour certains cinéastes des origines, comme Méliès, ces frictions entre le corps et le cinéma occupent même une place essentielle dans un dispositif où ce que l’on regarde s’impose comme une épreuve du voir assimilée aux possibles et impossibles distinctions entre le réel et l’irréel. En revoyant aujourd’hui l’Homme à la tête de caoutchouc ou de Gravitations, on comprend d’autant mieux comment l’exploitation du corps était au principe des techniques de divertissement qui ont précédé le cinéma (cirque, music-hall, attractions diverses) : il s’agissait d’exhiber l’étrangeté de corps hors normes qui, au moins depuis la Vénus hottentote, exerçait une forte séduction sur des publics très variés. Il était aussi question d’exhiber l’altérité dans ses aspects les plus spectaculaires. Ainsi en est-il du fameux Freaks, La monstrueuse parade de Tod Browning dont les historiens du cinéma n’ont de cesse de nous rappeler que les nains, les hommes-troncs, les sœurs siamoises et autres femmes à barbe ne sont pas des acteurs maquillés, mais bien des authentiques « monstres et anormaux » que l’on nous présente à l’image, comme pour compenser le régime d’illusion auquel le cinéma nous a si vite habitué. Le corps y sert là l’immédiate question du normal et du pathologique jusqu’à renverser notre jugement de valeur sur les apparences et les peurs qu’elles peuvent susciter en nous. Car comme le rappelle le réalisateur Georges Franju « montrer un personnage anormal faire des choses anormales ne fait pas peur. Il faut montrer un personnage normal faire des choses anormales ou bien un personnage anormal faire des choses normales ».
Le cinématographe a tiré ses premières ressources de la spectacularité nouvelle du corps humain que permettait l’image-mouvement en ses dispositifs les plus frustes : il n’est pas indifférent que le cinéma des origines ait tiré parti du filmage de saynètes pornographiques et que le travestissement et le déguisement aient joué un rôle central dans les premières intrigues mises en images. Dans l’histoire du cinéma commercial, la question de la définition du corps montrable a été un enjeu essentiel dans la production de normes et de la constitution d’un espace de possible transgression : la référence au code Hays, qui a régi pendant des décennies la présentation du corps dans le cinéma américain, vient immédiatement à l’esprit. Les limites du corps montrable, décent, aseptisé dessinaient en creux d’autres espaces, illicites, obscènes, où s’éprouvaient d’autres manières de filmer les corps et leurs interactions. Les écritures filmiques qui se sont posées cette question ont, au reste, conduit à des esthétiques où le spectateur est pris à partie par l’entremise de la suggestion. Dès les années 1940, à côté des grandes productions hollywoodiennes, on voit ainsi naître aux Etats-Unis, un cinéma de la suggestion porté notamment par le très subtil producteur Val Lewton qui va mettre en chantier des films tels que La Féline réalisé par Jacques Tourneur ou La septième victime de Mark Robson. Le corps de la femme y est mis chaque fois implicitement en questions : dans La féline, en interrogeant les frontières humanité-animalité qui animent les actions de ce corps, dans la septième victime, en questionnant, comme le fera quelques années plus tard Polanski avec Rosemay’s Baby, les sensations d’isolement et l’omniprésence des menaces que les grandes villes font peser sur l’identité corporelle. Dans ces deux films, comme dans les autres productions de Robson, rien n’est ouvertement montré, le corps y est juste, redessiné par des ombres et des lumières, il faudrait plus justement dire, du sombre et du lumineux.
Par la suite, presque tous les cinémas spécialisés, du pornographique au fantastique, vont être caractérisés par une proposition alternative de traitement des corps. Beaucoup de mouvements dans l’histoire du cinéma ont été déterminés principalement par un changement, une disruption de l’ordre corporel cinématographique dominant : il s’agissait de montrer plus de corps, la question de la nudité devenant centrale, ou de montrer d’autres corps, par l’introduction de personnages au physique ordinaire, à la différence du corps fabriqué des stars, qui ont connu bien avant les bourgeoises les promesses et les affres de la chirurgie esthétique. Le corps des stars, particulièrement des femmes, est, dans le cinéma américain des années 1950 en particulier, à la disposition totale du système productif : on peut faire ce qu’on veut de ces supports physiques, jusqu'au risque de les conduire à la mort, comme en témoigne, parmi bien d’autres, le destin tragique de Marilyn Monroe. La plasticité des corps au service de la production est ici une donnée fondamentale. La maltraitance, fût-elle rendue invisible par la glorification du corps des actrices, est sans doute consubstantielle à une bonne partie de l’histoire du cinéma. Le système vient fréquemment rappeler à ses actrices, mais aussi à ses acteurs, que la gloire qui s’attache à leurs propriétés physiques magnifiées par le filmage n’est jamais garantie au delà de la représentation, voire de la recette. Représenter un corps au sommet de sa beauté consiste aussi à programmer sa déchéance. Hollywood ira même jusqu’à créer une filiation des actrices au corps meurtri de mère en fille. L’exemple le plus cinglant est la façon dont Brian De Palma joue à nous faire voir (croire) à la lacération du corps de Melanie Griffith dans Body Double, faisant ainsi directement écho aux lacérations subies par sa mère dans la vie, l’actrice Tippi Hedren dans les Oiseaux d’Hitchcock. Le corps lacéré s’impose là comme une référence, un hommage qui s’assimile peu à peu à un sacrifice ritualisé.
Le corps de l’industrie cinématographique est un leurre. La légende du cinéma est pleine d’anecdotes tragiques où s’accumulent les corps déchus. Il est important sous ce rapport d’évoquer la question du vieillissement du corps au cinéma : l’œuvre de Clint Eastwood accorde à cette dimension une place centrale, depuis Unforgiven jusqu’à Space Cowboys. Comment vieillir au cinéma ? Voilà bien une question que la division sexuée de la vie sociale détermine largement. Il est plus facile pour un homme de montrer au cinéma des ans l’irréparable outrage, comme le fait Clint Eastwood avec une délectation ambiguë, car il a de beaux restes, lorsqu’il exhibe devant la caméra les multiples plis de son cou dans ses films les plus récents. Dans un mouvement contradictoire, le cinéma a glorifié les corps à l’aide d’artifices (l’éclairage étant ici central) bien plus élaborés que ceux du théâtre, ou même du music-hall, où le gros plan est impossible, mais il a aussi exhibé leur fragilité d’une manière tout à fait inédite dans l’histoire des spectacles. Invulnérabilité du corps glorieux de l’acteur d’un côté. Mise en danger permanente de la présence physique de l’acteur de l’autre. Les belles et les bêtes sont évidemment incarnées par des personnages fort différents. Les mondes des corps cinématographiques n’ont guère d’intersections. Marilyn Monroe a très peu de chances de finir dans les bras de Bela Lugosi. Pourtant, quelques figures archétypiques de l’histoire du cinéma concernent la rencontre improbable de la bestialité et de la beauté, dont King Kong, en ses différentes versions, est la plus belle illustration. Le traitement du corps au cinéma est traversé par la question du rapport de l’homme et de l’animal, de la beauté et de la monstruosité, et plus généralement, du rapport de l’humain et du non humain. Si le cinéma reprend le vieux fond des mythes et des légendes, qui traite principalement de ces questions, il les soumet à de nouveaux types de traitement (travellings, trucages, plan rapprochés), qui donnent une intensité nouvelle aux formes imaginaires du passé et créent des configurations inédites.
Dire que le corps est comédie, c’est d’emblée signaler que l’une des propriétés du cinéma, depuis ses origines, est de centrer l’attention sur la dimension spécifique de la corporéité dans la vie sociale, qui apparaît le plus souvent comme un corps à corps, comme une mise en présence d’habitus hétérogènes et de trajectoires irréductibles. La présence physique constitue une part irréductible de la mise en forme cinématographique : l’image-mouvement permet d’abord, même en ses formes inchoatives, de multiplier les points de vue sur les corps et sur leurs propriétés interactives, dont la relation amoureuse n’est qu’une occurrence parmi d’autres. Elle offre ensuite de déplacer les corps et de les catapulter dans des espaces multiples. Elle permet enfin de les déconstruire, de les décomposer et le les recomposer ad libitum. Le cinéma de Buster Keaton est particulièrement intéressant dans cette perspective : loin d’être le simple prolongement de tradition de présentation du corps hérité du spectacle forain, il contribue à un cheminement complexe vers une sorte de théorie des modes de composition des formes corporelles qui contribuent à le détacher de l’univers comique dans lequel il se trouve pris à l’origine. A ce titre, le corps n’existe jamais pour lui-même dans un espace particulier de monstration qu’on appellerait cinématographique. Il est plutôt un point d’appui pour des transformations et pour des constructions mentales élaborées qui vont bien au delà d’une configuration destinée à la pure exhibition plastique. Chacun sait qu’Ava Gardner avait été surnommée « The Body » en raison de son extraordinaire prestance physique. Mais ses admirateurs passés et présents sont convaincus que ce corps parfait n’était qu’une voie d’accès aux promesses de l’esprit. Elle-même n’admettait pas de se voir confinée à une stricte réalité corporelle, et elle avait raison.

Le cinéma permet aussi une exploration approfondie des formes de domination sociale ou sexuelle qui passent par la soumission ou la domestication des corps. Art de la mise en relation entre les corps, le cinéma a également excellé à la confrontation, souvent brutale, des habitus de classe, des relations de sexe ou de génération. Le succès des grands films de combat où le corps se met en péril pour conquérir une reconnaissance sociale est en ce sens purement cinématographiue. Car le cinéma nous présente le corps du boxeur hors du ring : Rocky, Raging Bull, Rocco et ses frères, Nous avons gagné ce soir ou Homeboy, sont autant de films qui fonctionnent toujours en faufilant la métaphore entre le corps exposé sur le ring et le destin social de celui qui décide d’entrer dans le combat. Ce sont, au demeurant, ces relations du corps et du monde social qui sont directement à l’origine des projets des films hongkongais écrits et interprétés par Bruce Lee qui tenait tant à mettre en scène son corps maîtrisé grâce la pratique du kung-fu qui l’avait - répétait-il - « sauvé de la délinquance ». Hiérarchie des corps et des destins sociaux constituent un objet privilégié par l’œil cinématographique qui traitent les corps comme de ressources inégalement distribuées.
Les contributions réunies dans ce numéro n’ont pas la prétention de traiter exhaustivement de la question du corps au cinéma. Comme on l’a déjà compris, le sujet est aussi vaste que le cinéma lui-même. Il s’agit simplement de confronter des problématiques diverses et irréductibles à un mode commun d’analyse, mais qui partagent le souci de traiter des objets dans leur dimension spécifique. Le projet ne consiste pas à aboutir à une conclusion qui dirait la bonne manière de traiter la question du corps au cinéma (il n’y en a tout simplement pas) mais de laisser ouverte la confrontation entre des approches différentes, sémiologiques, historiques ou sociologiques, mais dont aucune n’ignore le primat de l’inscription sociale des corps dans la spécificité du monde cinématographique.
Les six articles centraux de ce numéro explorent chacun une dimension des modes de présence du corps au cinéma : le corps héroïsé du cinéma d’action d’abord, que Frédéric Maguet analyse à l’aide d’une grille importée pour une bonne part de l’analyse littéraire et particulièrement de la morphologie du conte de Wladimir Propp. La performance exceptionnelle que peut manifester un corps face à des formes d’adversité multiple est une constante de l’histoire du cinéma. Le succès du cinéma asiatique a profondément renouvelé les figures de ce corps performant, invraisemblable de bout en bout, mais néanmoins source de plaisir toujours renouvelé : le spectateur ne s’étonne pas de voir apparaître des mouvements de kung-fu dans un film qui se déroule sous le règne de Louis XV. F. Maguet remarque dans sa féconde analyse qu’il existe un découplage entre l’apparence physique du héros, telle que l’exprime son corps ordinaire et sa capacité de réaliser des exploits. Occultation de l’histoire (les arts martiaux asiatiques ont une histoire qui disparaît de plus en plus à mesure que les gestes du kung fu deviennent un code universel) et effacement de tout réalisme physique dessinent alors une forme spécifique de la corporéité cinématographique, ce que l’auteur appelle « régime d’utopie » dont le principe de fonctionnement doit être trouvé dans une « médiation somatique » qui établit un lien entre le corps réel et le corps fantasmé. Le corps génère ici la comédie puisqu’il institue l’espace propre de la fiction et son mode de croyance particulier.
Damien Malinas et Virginie Spies ne traitent pas du contenu filmique mais envisagent la dimension physique de la relation au cinéma et revisitent ainsi, de manière originale, la vieille question de l’identitification du héros et du spectateur. Les auteurs de l’article élargissent toutefois le débat en inscrivant l’identification dans une problématique de l’identité. C’est que le cinéma n’est pas seulement le loisir culturel le plus pratiqué par les jeunes générations, mais qu’il est aussi un puissant vecteur de sociabilité et de construction de soi. Etudiant avec précision, en utilisant les ressources variées de l’enquête, le moment à la fois décisif et transitoire de la vie étudiante, l’affiche (de star) installée dans la chambre est susceptible d’investissements multiples : c’est un identifiant facile qui permet de « dire et de se dire » sans long discours à autrui, mais c’est aussi un outil de pratiques intimes et solitaires où le support de papier est vraiment le signe du corps absent de la star. Ce travail foisonnant prolonge clairement des travaux antérieurs, ceux d’Edgar Morin en particulier, mais il permet aussi de penser la double relation à l’image corporelle de la star : la première, sans doute plus analysée, qui privilégie un rapport solitaire, la seconde, sans doute sociologiquement plus productive, qui en fait le support d’une sociabilité de transition.
Olivier Thévenin associe le corps et le culte, dont on peut pressentir qu’ils sont étroitement liés. Revenant sur l’appropriation post-mortem de l’œuvre d’Ed Wood, il montre à quel point la charge négative attachée à un corps travesti et présenté à son désavantage, symbole d’une vie artistique ratée, peut devenir le support d’un réinvestissement qui va affecter d’un signe positif tous les éléments de l’hexis corporelle de l’acteur et du cinéaste. Le culte d’un vampire raté commence avec la réévaluation de son corps commence avec la réévaluation de ses propriétés corporelles et à travers la donation de sens à des images corporelles qui ont signifié dans un premier temps le ratage à la fois physique et cinématographique. Ed Wood où le corps retourné, pourrait-on dire. Ce faisant, O. Thévenin montre que le corps n’existe pas seulement dans l’ici et maintenant de la production cinématographique. Il voyage au contraire dans l’espace de l’histoire culturelle, et revêt des significations impensables lors de sa gestation comme objet de cinéma.
Dominique Memmi, en un article séminal, fait porter l’attention sociologique pour la question de la domination des corps à leur expression cinématographique. Pour l’auteur, le matériau filmique peut contribuer à définir un espace inédit d’épreuve pour la recherche d’issues à des problèmes d’ordre individuel ou collectif qui mettent en jeu des confrontations corporelles, ordinairement dans des relations d’inégalités de ressources. C’est ainsi que les relations de domesticité, qui supposent à la fois la proximité des corps dans la vie quotidienne et l’existence d’une barrière sociale infranchissable fait l’objet d’une partie non négligeable de l’histoire du cinéma, que l’auteur parcourt rapidement mais de façon très suggestive. Le cinéma est le lieu par excellence de la production de représentations des identités et des relations corporelles. Il peut être aussi envisagé, comme nous y invite cet article, comme un espace expérimental qui permet d’éprouver des formes plus réflexifs des relations entre des corps sexués.
On se tromperait s’il l’on imaginait qu’on passe avec la contribution de Jean-Pierre Esquenazi à un registre plus léger : c’est aussi à une sémio-sociologie de la domination qu’il apporte des perspectives neuves en traitant de la question, à la fois massive et difficile à traiter, de la relation entre Hitchcock et « ses » femmes de cinéma. Si l’image du démiurge apparaît ici dans la mesure où le savoir-faire du cinéaste conduit à une maîtrise absolue de la gestion des corps cinématographiques, et particulièrement des corps féminins, consciencieusement « massacrés », il n’en reste pas moins qu’Hitchcock, empêtré dans un habitus post-victorien et embarrassé d’un corps volumineux, est capable de renverser la perspective et d’offrir, au moins partiellement, une vision provenant du corps et de la sensibilité féminine. L’article de J.P. Esquenazi nous permet de cerner l’ambivalence du geste démiurgique de l’auteur et du fantasme de maîtrise absolue. Le corps féminin se rebiffe et se met à parler pour lui-même. Le cinéaste ne semble pas croire à la possibilité d’un retournement de situation où la femme arrêterait le massacre en suspendant le cours ordinaire du récit masculin. Mais la possibilité, au moins théorique, d’un rééquilibrage des relations entre corps est ouverte par l’ambivalence hitchcockienne.

Par son analyse serrée des mécanismes de la censure cinématographique dans la théocratie islamique iranienne, Agnès Devictor nous permet de poser à nouveaux frais la question des limites du contrôle externe de la production cinématographique par un ordre politique. Elle nous montre d’abord à travers l’étude détaillée de la production d’un code rigide concernant les modes d’apparition du corps, particulièrement féminin, au cinéma, et par sa répression absolue de toute interaction tactile, l’auteur offre une contribution remarquable à l’analyse des formes d’inscription idéologico-politique de la production d’images cinématographiques. L’analyse ne s’arrête pas là : il y a une contrepartie à la volonté panoptique du pouvoir, quelque chose qu’on pourrait appeler la résilience spécifique du cinéma. En effet, l’analyse d’œuvres de trois réalisateurs, met indiscutablement en évidence l’irréductibilité du cinéma au code de censure. Ils ont pu parvenir à l’incarnation de leurs personnages féminins en respectant les règles extrêmement contraignantes de la censure. La signification de ces films passe moins par la dimension discursive des interactions que par la densité corporelle, qui suppose un usage particulier du temps, des actrices principales. Cette relation au corps serait à rapporter aux pouvoirs propres du cinéma, qui se situent au-delà, ou en deçà du narratif, mais dans une dynamique de l’incarnation ou de la présence réelle. Le code de censure s’efface pour ainsi dire car il n’a plus de prise sur ces corps.
À la lecture de ces différents articles, on est en mesure de supposer que la médiation corporelle, surtout si on l’inscrit dans une logique du temps, intervient comme un élément central pour penser ce que serait un pouvoir spécifique du cinéma, qui le rendrait à la fois irréductible à toute mise en forme idéologique aussi bien qu’à tout carcan narratif.
 Sociologie du cinéma et de ses publics
Sociologie du cinéma et de ses publics